
La transition écologique est comme La Lettre volée d'Edgar Allan Poe, on se demande où elle a bien pu passer. Elle était pourtant là devant nous, en évidence, mais les décideurs font mine de ne pas-plus la voir, comme s’ils préféraient la dissimuler sous des prétextes trompeurs. La vérité, c’est que nous hésitons à en emprunter le chemin résolument. Les enjeux écologiques sont connus, sous nos yeux, mais c’est comme si nous ne les percevions plus clairement. La question environnementale se retrouve dans un mouvement de balancier assez inquiétant, minimisée, quand ce n'est pas remisée, voire niée, alors qu'elle est toujours là, pas moins présente qu’'il y dix ans.
On sait pourtant depuis la Cop 21 et les Accords de Paris que la transition nécessite une approche nouvelle et innovante, des experts l'ont documenté et les autorités ont établi un cahier des charges, une feuille de route. On sait pertinemment que les solutions conventionnelles ne suffisent pas, qu’on ne peut pas tout attendre des solutions technologiques, mais on tergiverse de nouveau à repenser pratiquement notre rapport à l'environnement, à la croissance, dans un stop and go inversé qui semble incessant, alors que la nature même de la transition commande un minimum de constance et de méthode dans sa mise en œuvre.
Ce n'est pas que la prise de conscience n'ait pas eu lieu, une stratégie a été arrêtée, des décrets et des lois ont été pris et votées, des secrétariats mis en place, un Plan national intégré énergie-climat (PNIEC) déposé en juin 2024 auprès de Bruxelles, mais force est de constater qu'elle semble régresser depuis quelque temps, et singulièrement chez les responsables politiques. On sait au fond de nous que le temps presse, mais on fait comme si les retards dans l'action n'auront finalement pas tant que cela de conséquences graves, comme si déconstruire nos comportements pour adopter des pratiques plus durables était, c'est selon, trop dur, trop fatigant, ou juste un truc de bobos, autrement dit une foutaise. Comme si « L'environnement, ça commence à bien faire » du Président de la République, Nicolas Sarkozy, en 2010, après avoir préempté l'écologie pour réduire le champ de ses opposants, avait déteint sur les esprits. Pire : comme s’il avait élargi la voie aux grenello-sceptiques, amplifié le doute quant à la part humaine dans le dérèglement climatique (pourtant mille fois démontré par le groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat - GIEC), et pollué ainsi durablement les consciences. Comme si les déclarations à l’emporte pièces, les prédications d’un président des Etats-Unis sur le dérèglement climatique encore récemment réitérées devant l’assemblée générale de l’ONU du 25 septembre le décrétant comme une « supercherie inventée par des gens aux intentions malveillantes » s’infusaient jusqu’en Europe, disqualifiant les politiques climatiques en les présentant comme la « plus grande arnaque jamais perpétrée contre le monde ».
Ce n'est pas que des progrès n'ont pas été réalisés : entre 1990 et 2023, les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont ainsi diminué en France de plus de 30 % s'accordent à dire les observateurs. Mais les effets de la politique de décarbonation se font aujourd'hui moins sentir, illustrant clairement, sinon une baisse, du moins l'insuffisance des efforts dorénavant déployés pour remplir la feuille de route des engagements climatiques de la France et observer la « trajectoire de -55 % des émissions en 2030, et de neutralité carbone en 2050 ».
Il n'en reste pas moins que les relevés en attestent : + 0,5% de hausse des gaz à effet de serre au troisième trimestre 2024.
Ce qui est dommage, car la France avait un certain allant sur le sujet et faisait encore il y a peu figure de locomotive au niveau européen, elle n’est plus en mesure de contrer les velléités récentes de la commission européenne d’amorcer un recul des ambitions environnementales au profit de ce qui est présenté comme la « compétitivité ». C’est vrai en matière de lutte contre le greenwashing : la Commission a décidé de retirer une proposition visant à garantir que les déclarations environnementales des entreprises soient exactes et vérifiées. C’est vrai en matière de devoir de vigilance : la Commission propose de reporter d'un an l’application de la Directive et de réduire son périmètre.
C’est vrai en matière de durabilité des entreprises : la Commission souhaite restreindre l'obligation de reporting aux très grandes entreprises de plus de 1 000 salariés. Et tout ceci au nom d’une nécessaire simplification des textes européens (législation "omnibus") et des contraintes extérieures…Avec un risque de laisser-faire généralisé.
Alors même que l’on aurait pu imaginer que la France, peut-être plus agile intellectuellement que d’autres, pousse à la vitesse supérieure en plaidant, à l’instar de l’économiste post-keynésien Edwin Le Héron (1), que les marchés financiers étant incapables de prévoir les risques à long terme et de financer des projets peu rentables à court et moyen terme, il convenait d’envisager des choix politiques et des investissements européens de long terme, non contraints par des ressources budgétaires ou d'épargne préalables.
Cette perspective est repoussée d’autant depuis le changement de majorité politique au Parlement européen et il faut craindre qu’aucune proposition ne soit simplement mise sur la table pour y être discutée avant longtemps en vue par exemple de structurer un budget d'investissement européen financé par l'endettement et le soutien monétaire, notamment via la Banque Centrale Européenne (BCE). Loin des promesses initiales de transition vers des « énergies durables », il n’est que de voir déjà combien la BCE ne s’est toujours pas franchement interdite de financer des énergies fossiles en acceptant d'augmenter la part des crédits verts dans son bilan.
La transition ne peut pas être une variable d’ajustement
C'est le même phénomène de repli ou d'atermoiements que l'on peut observer pour les questions liées à la protection de la diversité de la vie (Cf. le naturaliste et écologiste français Yves Paccalet), autrement plus communément (mal) appelée "biodiversité". Car le défi actuel ne se réduit pas qu’à la seule décarbonation, il concerne la protection de toute la variété des formes de vie sur Terre, aussi bien la diversité des écosystèmes, des espèces, que la diversité génétique, qui concourent à la production d'oxygène, la pollinisation des cultures, la régulation du climat et la « fourniture » de ressources naturelles. On semble en train de l’oublier.
Si tant est qu’on y arrive, on sait que la modification de notre modèle énergétique ne suffira pas à améliorer certains impacts du dérèglement climatique. Les experts scientifiques nous disent – ce que nos ascendants savaient déjà – que si on veut vraiment capter le carbone, la priorité devrait être la sauvegarde des forêts, des tourbières et des prairies, plutôt que de compter exclusivement sur d’hypothétiques solutions technologiques.
Un exemple frappant : 31 % des oiseaux spécialistes - dénommés ainsi lorsqu’ils utilisent un seul type de ressources ou d’habitat, comme l’alouette des champs par exemple, ce qui les rend très dépendants de ce dernier et donc immédiatement affectés par les perturbations de sa ressource ou de son habitat - ont disparu entre 1989 et 2023. Les écologues du centre d’études biologiques de Chizé (Deux-Sèvres, 79) ont ainsi constaté une perte de près de la moitié des effectifs chez l’alouette des champs en l’espace de 30 ans soit une perte de 1% d’effectif / an qui se poursuit. On ne peut pas miser que sur la résilience de la nature. Tandis que l’artificialisation des terres n'est pas maîtrisée, malgré l’objectif légal d’arriver à "zéro artificialisation nette en 2050" (dont on pourrait discuter par ailleurs du réalisme de l'objectif, et de l'efficacité du message en termes de communication), illustrant notre impuissance et/ou notre manque de détermination à réduire la pression sur les milieux naturels.
Le bilan n'est guère plus brillant pour les déchets ménagers, malgré tous les efforts déployés, qui auraient augmenté de 13 % entre 2010 et 2022, très loin en tous les cas de la trajectoire prévue de -15 % par habitant entre 2010 et 2030.
Côté pollution, si la qualité de l’air s’améliore grâce à la diminution des particules fines, les nouveaux polluants semblent peu encadrés.
Idem s’agissant du cycle de l’eau, l’acidification des océans, la pollution de l’air, l’usage des sols…
En réalité, la régression se situe surtout dans le fait que nous sommes quasiment en face d'un déni culturel qui n'était avant que l'apanage d'une minorité d'opposants à la notion même de dérèglement climatique, facilité aujourd’hui par une certaine américanisation du débat culturel en France et en Europe, par l’importation d’une vision alternative de la réalité (alternative facts), sur ce sujet comme sur d’autres. Il est difficile de ne pas y voir le symptôme d’une contre-révolution écologique en cours au sein de l’Union européenne depuis les élections de juin 2024 qui ont modifié l'équilibre politique, faisant émerger une majorité de droite à l'extrême droite hostile au Pacte vert.
Un déni qui risque de prospérer avec les nouvelles générations, celles qui sont à l'école aujourd'hui. Rien d'étonnant à cela quand on voit qu'après la relégation (ancienne) de l'enseignement des humanités, les cours de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) ont quasiment disparu des enseignements du lycée, et que le choix de spécialité dans beaucoup trop d'établissements n'est pas respecté en cette rentrée scolaire 2025.
Il faut bien reconnaître aussi que l’idée que la préoccupation écologique entraîne de facto un changement de comportement est erronée: Thierry Libaert, spécialiste des stratégies de communication environnementale, qui préside le conseil scientifique du PRé, l'a souvent démontré : tous les citoyens ne modifient pas leurs habitudes malgré leur conscience des enjeux. Songeons que s’ils s’estiment à 75% engagés par rapport aux générations précédentes (mais aussi par rapport aux générations plus jeunes, à hauteur de 65%), l’engagement des 15-25 ans reste « marginal » selon entre autres une étude de l’Ademe, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (réalisée par l’institut de sondage OpinionWay,) parue en 2023. Ils ne seraient que 9% à s’engager dans une association de défense de l’environnement (alors qu’ils perçoivent l’associatif comme le must de l’engagement environnemental) et seulement 14% à avoir déjà participé à une manifestation pour le climat. Leurs raisons pour expliquer ce manque d’engagement : le manque de temps, d’envie ou de motivation, ce qu’ils identifient, pour certains, comme une forme d’égoïsme.
La tendance au recul se voit aussi dans les politiques climatiques des banques :
Selon le rapport « Banking on Climate Chaos » (2), les financements de l’énergie fossile des six grandes banques françaises afficheraient ainsi une augmentation en 2024 de +19,2 %, soit quelques 6,9 milliards d'euros supplémentaires, passant de 36 milliards d'euros débloqués en 2023 à 42,9 milliards d'euros en 2024. La Fédération bancaire française, préfère parler de son côté d’un désengagement du fossile "progressif".
Certes la conjoncture économique, le contexte de contrainte budgétaire, l'instabilité et le manque de perspectives politiques, la poussée des postures populistes, n'aident pas et peuvent conduire à une temporisation des acteurs locaux, sociaux ou industriels qui préfèrent voir venir. Mais ils n'expliquent pas à eux-seuls que la gouvernance de la transition écologique soit en souffrance, comme si la planification écologique, un objectif annoncé par le Président de la République en 2023 consistant en une méthode globale, qui puisse permettre d’agir plus rapidement de façon coordonnée et relever les défis majeurs de la transition écologique, était devenue une simple variable d’ajustement, pire un gros mot. Ce qui est sûr, c'est que la multiplication des plans, des stratégies, des normes et des échelons de décisions entre les différentes collectivités et l’Etat ont pu rendre l’action peu lisible, parfois incohérente, et entraînant possiblement des surcoûts. Au risque de susciter un certain aquoibonisme. Il est donc plus que jamais impératif d'investir dans la territorialisation de la transition écologique tout en renforçant le pilotage national, avec de vrais leviers, que ce soit par le secrétariat général à la planification écologique (SGPE) né en 2022 sous l’impulsion d’Elisabeth Borne, alors Première ministre, grandement affaibli depuis par la valse des locataires de Matignon et le départ de son fondateur l’ingénieur des Mines Antoine Pellion, ou par tout autre dispositif. Mais rien ne sera possible, sans une volonté politique retrouvée au sommet de l'Etat. Une pétition citoyenne « pour la protection de l’environnement et la transition écologique » vient d’être adressée en ce sens à l’Assemblée nationale.

La transition moins coûteuse que l’inaction
C'est peu de dire que le Rapport de la Cour des Comptes sur la Transition écologique - une Première - sorti le 16 septembre, précis et assez complet, pointe les retards pris par la France. Avec une implacable lucidité, il met l'accent sur les résultats insuffisants de notre pays pour atteindre les objectifs initialement fixés. Il met en lumière les « retards » de l’État, ses atermoiements, celui des collectivités (qui manquent par ailleurs souvent de moyens) et des entreprises en matière d’adaptation au changement climatique. Il souligne surtout que l’État ne joue pas correctement son rôle de stratège : pas d'objectifs clairs et une trajectoire pour les atteindre assez floue et pour le moins en zig zag. Enfin, il souligne « l’urgence » d’agir et sur le plan climatique, énergétique et sur le plan de la biodiversité, considérant que cette dernière ne doit pas être « la victime des efforts budgétaires ».
Avant lui, celui du Haut Conseil pour le climat publié début juillet 2025 n’avait pas été plus tendre et avait stigmatisé un manque de lisibilité des politiques publiques, pointant des reculs « inquiétants », un « pilotage affaibli », une loi d’orientation pour l’agriculture manquant d’ambition écologique, relevant des tentatives d’affaiblir le développement des énergies renouvelables, etc. Le HCC alertant au final sur ce qu’il appelle une « fragilité de gouvernance ».
L’équation est certes difficile concernant par exemple le volet énergétique de la transition où les pouvoirs publics enjoignent de faire plus et mieux avec moins. Ainsi, s’agissant de la seule rénovation énergétique des logements qui intéressent directement les particuliers, la subvention versée par l’Etat pour financer la principale aide publique pourrait s’élever à 2,1 milliards d’euros en 2025, alors que le budget de 2024 prévoyait 3,1 milliards d’euros de crédits de paiement et que les retards pris auraient exigé un investissement supplémentaire. Alors même que le secteur du bâtiment représente, à lui seul, près de 45 % de la consommation finale d’énergie et 25 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau national, et que la France s’était promise d’atteindre, en 2030, le seuil des 900 000 rénovations globales de logements par an (Cf. le secrétariat général à la planification écologique - SGPE). Nous aurions déjà dû franchir, en 2024, la barre des 200 000 rénovations d’ampleur, aidées par MaPrimeRénov’, la principale aide publique à la rénovation énergétique des logements. Nous sommes loin du compte : seuls 91 000 logements ont bénéficié d’une rénovation d’ampleur en 2024.
La Cour recommande des objectifs par secteurs (on pouvait croire benoitement que c'était déjà le cas ?!), elle évoque l’idée d’une territorialisation de la planification écologique - une voie pragmatique, pratique, garante d'efficacité (évoquée par le PRé depuis 2011) qui stipule la prise en compte pour chaque territoire d’objectifs et suggère la mobilisation et le déploiement de la planification, qui doit en premier lieu avoir lieu dans et avec les collectivités territoriales, via notamment des COP régionales, en lien avec les administrations et élus des départements et communes, les entreprises, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les associations environnementales, les citoyens - et recommande de renforcer le rôle du SGPE, actuellement on ne peut plus « fragilisé » pour ne pas dire mis entre parenthèses (depuis près de deux ans en vérité).
« En dépit de son action positive, la position du SGPE a été fragilisée et son influence sur la prise de décisions réduite », regrette la Cour qui invite à lui redonner du pouvoir d’impulsion pour coordonner les politiques sectorielles, arbitrer entre certaines priorités, et assurer la cohérence entre les objectifs environnementaux et les moyens financiers.
Car la transition écologique et principalement énergétique ne se fera pas sans moyens et les subventions publiques restent indispensables, souligne la Cour, notamment pour des financements qui ne relèvent pas de logiques purement marchandes, comme la qualité de l’air, ou pour dérisquer des investissements. Dans un rapport publié fin décembre, le SGPE estimait que les trois quarts des actions à réaliser nécessitaient une aide publique.
La Cour ne manque pas de mettre l'accent pareillement sur l’importance de l'outil fiscal, à commencer par la nécessaire réduction des niches dites « brunes », ces avantages fiscaux spécifiques qui bénéficient aux énergies fossiles, telles que le pétrole, le gaz et le charbon, dans les secteurs notamment du BTP, énergie, agriculture, transports, défavorables à l’environnement, qui représentent 8,1 milliards d’euros en 2025, sur les carburants fossiles agricoles par exemple.
La Cour des Comptes dans son Rapport 2025 exhorte à renforcer la Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique (Spafte). C'est qu'il y a un besoin estimé de 110 milliards d’euros/an d’ici 2030, qui oblige à dégager en urgence des sources de financement public sans alourdir la dette tout en ayant le courage les réformes structurelles et sans doute institutionnelles adéquates. Tout en soulignant l'importance d'une « réorientation massive des flux de financements » et d'une « répartition de l'effort financier entre tous les acteurs économiques » pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.
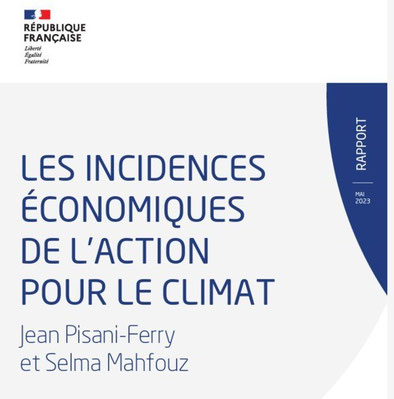
Pour bien mesurer ce que cela veut dire, songeons que l'ancien directeur du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii) et ancien commissaire général de France Stratégie, Jean Pisany-Ferry - dont on peut préciser qu'il s'était engagé dans la campagne présidentielle de 2017 en faveur d'Emmanuel Macron - a rendu en 2023 (avec Selma Mahfouz, IGF) à la demande de la première ministre Elisabeth Borne un rapport sur Les incidences économiques de l’action pour le climat (3), dans lequel était chiffré à 34 milliards d’euros par an l’investissement public supplémentaire à réaliser d’ici à 2030. Il réclamait un financement plus équitable de la transition et appelait à « programmer l’investissement climat sur trois décennies », plaidait pour un recours à l’endettement, considérant le financement précisément plus comme un investissement que comme une simple dépense, et préconisait de mettre en place un « impôt exceptionnel et temporaire » sur le patrimoine financier des 10 % de Français les plus aisés, à hauteur de 5 milliards d’euros par an. Récemment il a réitéré ses regrets en la matière à l'occasion d'une cérémonie de remise des insignes d'officier de la légion d'Honneur (4).
La Cour relève de son côté « le besoin d’une stratégie financière plus rigoureuse et d’une meilleure évaluation ex ante des dispositifs d’aide ». Elle souligne que « le coût de la transition écologique » est « bien inférieur à celui de l'inaction ». Sachant que ce coût va croître avec le retard pris dans la conduite des transformations et que « chaque euro investi dans la prévention et dans une transition ordonnée aura un effet économique et social positif », d’autant plus que ces investissements seront réalisés tôt. Au point que Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, appelle à ne pas utiliser l'écologie comme une « variable d'ajustement budgétaire ».
Elle recommande des efforts partagés en associant le secteur privé (ce qui est su depuis au moins 2012) pour satisfaire les besoins annuels estimés pour couvrir tous les volets de la transition écologique, qui représentent le double des financements actuellement mobilisés, acteurs privés et publics confondus. Elle recommande dans le même temps d'évaluer la capacité financière des ménages pour adapter les aides.
Où est passé le débat public ?
Il n'y a pas que la transition écologique qui suscite questions et inquiétudes. Incidemment, nous pourrions relever de la même façon combien depuis plusieurs mois le rôle de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) - qui joue un rôle clé dans la transition en organisant précisément des débats publics pour informer et consulter les populations sur des projets environnementaux, avec l’ambition d’assurer ainsi transparence, neutralité et inclusion pour des décisions les plus légitimes et démocratiques possibles - est mis en cause. Où est passée la participation citoyenne ? On pourrait dire la même chose par ailleurs de la qualité du dialogue social.
Qu’a-t-il été fait de l’analyse des cahiers de doléances de 2018-19 ?
Sommes-nous vraiment décidés à dépasser la crise de délibération actuelle ?
Des voix ici et là réclament de revenir sur les prérogatives de la CNDP, quand ce n'est pas sur ses moyens. Sans que grand monde ne fasse remarquer pour le moins que ce qui apparaît difficilement pour autre chose qu'une régression, là aussi, semble contraire, et à la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information environnementale et la participation du public au processus décisionnel (ratifiée par la France le 8 juillet 2002) - ce qui risque au passage d'amoindrir la capacité de nos concitoyens à saisir la justice pour défendre leurs droits environnementaux, et à l'article 7 de la Charte de l'environnement (2004) intégré au bloc de constitutionnalité (depuis la révision de 2005), ainsi que le note Jacques Archimbaud, ancien vice-pt de la CNDP (et membre du CS du PRé).
Ce dernier souligne, non sans raison, la faiblesse des "arguments" avancés, son regret qu'on ne fasse pas davantage confiance à l’élan civique des populations qui, dès lors qu'elles sont correctement informées, sont parfaitement capables de dépasser les postures binaires des "pour" et des "contre", et met en avant le fait que les vertus du débat public : il permet la revue des intérêts contradictoires et renforce la capacité des territoires. Pressentant cette remise en cause de la CNDP, nous pouvons confier ici que le PRé a tenté modestement un temps de parer aux éventuels mauvais coups portées contre la mission de la CNDP en essayant de favoriser un rapprochement avec le Conseil économique, social et environnemental (Cese) afin de la consolider. La chose ne put se faire butant sur un contexte politique ou simplement ministériel peu favorable. Il n'est cependant pas interdit de penser que les vents mauvais actuels contre la transition écologique et le débat public puissent transformer l'adversité en opportunité en promouvant une réflexion sur un système qui dépasserait les limites de la démocratie représentative et des aléas conjoncturels en intégrant d'une façon ou d'une autre les citoyens dans toutes les étapes de la fabrication des lois et des politiques publiques.

Et si le moment était venu de réfléchir sérieusement aux voies de ce que le constitutionaliste, agrégé de droit public, homme politique et ancien Résistant Léo Hamon (1908-1983) appelait une démocratie continue (5) - et plus près de nous, Dominique Rousseau - qui permettrait de renforcer la participation citoyenne, la légitimité des institutions et notre souveraineté écologique et, par le fait, la culture démocratique de tous ?
C’est aussi par le bas que le cap de la transition écologique sera maintenu et réussira à s’inscrire dans la durée, tout en ayant conscience que la planification écologique nécessite une approche multi-échelle (européenne, nationale, loco-régionale). Mais cela ne sera efficace que si le politique ne transige pas sur ses propres ambitions de gouverner la transition écologique, afin d’en garantir et d’en assurer la cohérence et l’efficience, la coordination institutionnelle, en s’engageant à une évaluation systématique des politiques mises en place. Comment pourrait-il s’exonérer de son devoir de protection en se ravisant et en donnant l’impression de s’en remettre à la Providence (du marché ).
Le PRé qui plaide pour une écologie des solutions depuis sa création, refusant toute posture de résignation ou catastrophiste ou de dégagement, a très tôt suggéré la mise en œuvre d’une planification écologique à long terme qui intègre les objectifs écologiques, environnementaux, dans l’ensemble de notre système institutionnel et administratif, en la rapprochant au plus près des territoires, pour en assurer la transversalité, la solidité, la viabilité et la durabilité. Et qui entraîne une vraie réforme, pour ne pas dire une vraie transformation de l’Etat. Avec des mesures d’accompagnement opportunes en termes de régulation et de gestion des biens communs que sont ou devraient être l’eau et l’air, les océans, l’espace.
Sachant enfin que la transition ne peut pas plus se faire sans le peuple que contre le peuple et que donc les modalités du développement de la concertation, du débat public, de l’adhésion populaire au processus doivent être sans peurs et sans reproches, transparentes et lisibles, confortées, grâce au concours d’un parlement réinventé et d’un Conseil économique, social et environnemental aux missions rénovées. Après la Convention citoyenne sur le climat, une initiative inédite en France de démocratie participative et délibérative (lancée en 2019) qui a accouché de 149 propositions législatives et réglementaires, presque tout reste à faire pour les traduire politiquement, entrer pleinement dans le concret et pour construire la légitimité des arbitrages. C’est assez désespérant.
Dans ses livres Sur le jadis et Abîmes et plus récemment dans Trésor caché, l’écrivain Pascal Quignard, ascète érudit et sensible, développe une réflexion sur le temps et la nature. Il voit dans la nature une manifestation de l'élan vital, empruntant ainsi la voie conceptuelle d’un Henri Bergson, qui représente une force créatrice et continue. Cette vision implique une certaine harmonie entre l'homme et la nature, mais aussi une reconnaissance de la fragilité et de la finitude des êtres vivants, dont l’humain, qu’il serait temps de ne pas oublier en refusant de se réfugier dans la nostalgie ou en rendant les armes à l’apocalypse. Je ne crois pas qu’il y ait un temps retrouvable. Je sais qu’on ne reverra plus la grande outarde dans les plaines de mon niortais. Et je ne vois plus guère de papillons de nuit qui sont en train de disparaitre. On a perdu beaucoup d’espèces de pollinisateurs sauvages, et pas seulement les abeilles domestiques et sauvages, mais aussi les papillons, des coléoptères, des mouches également, qui périssent à force d’insecticides systémiques. On scie la branche sur laquelle on est assis.
Je crois en la nécessité de savoir nommer les choses pour que le monde nous apparaisse tel qu’il est et que nous puissions le réparer, avant que de le changer le cas échéant. Pour l’heure, « il n’y a à peu près aucune politique publique qui insuffle de l’argent sur la recherche de solutions globales, de renaturation des milieux, de recréation de lien entre l’agriculture et la nature » explique l’écologue deux-sévrien Vincent Bretagnolle, promoteur de l’agroécologie et directeur de recherches au CNRS (in La Nouvelle République du Centre-Ouest, entretien du 14-01-2025).
Car en réalité la nature est le sujet de nos vies, elle est un trésor, elle n’est pas à côté de nous, elle est en nous et nous sommes en elle. Pourquoi devrions nous attendre d’entrer dans le grand âge pour savoir le nom des arbres, des champignons, des fleurs, des oiseaux et des insectes et mesurer la beauté mais aussi le tragique de nos existences ? Il est encore temps d’agir, de vivre.
" Ou allons-nous ? "
Un Auguste Dupin, comme celui de The Purloined Letter d'Edgar Allan Poe, pourrait-il résoudre notre « affaire (du siècle) » pour retrouver la lettre de la transition laissée vraisemblablement sur sa table par François Bayrou avant de quitter Matignon ?
Quoi qu’il en soit, il serait illusoire de croire que le positionnement des trois derniers gouvernements qui se sont succédé depuis 2024, s'il était repris par le nouveau gouvernement attendu - le cinquième depuis 2022 - puisse être d'une quelconque opérationnalité pour relancer la transition, retrouver le chemin d’une volonté politique, éviter l’effondrement de la planification écologique sous la poussée populiste, et dépasser un contexte de transition politique complexe. Le sujet de la transition écologique est un sujet on ne peut plus politique qui nécessite la plus large adhésion démocratique possible, une approche pragmatiste, évidemment des compromis parlementaires, également avec les acteurs économiques et sociaux, des décisions, une feuille de route, une constance et une méthode inscrites dans le long terme. Et sans doute un peu de créativité intellectuelle.
En commençant par admettre l’existence sinon d’une contradiction, du moins d’une tension fondamentale entre le développement du capitalisme et de l’écologie, sans s‘interdire d’interroger le « progrès » pour l’adapter à une certaine sobriété énergétique dans nos sociétés dites « riches » - qui ne peut valoir de la même façon pour un certain nombre de pays du Sud dits « pauvres » qui subissent une pollution, mais dont on voit mal comment ils peuvent s’en sortir autrement que par le développement - et en pensant ensemble ce qui est écologiquement nécessaire et ce qui est socialement juste.
De ce point de vue, il est plus que temps de soumettre à la question notre addiction à l’accumulation et de réfléchir à une société de post-croissance, ici, qui tournerait le dos à la démesure économique du dogme productiviste. Qui permettrait de faire le pas de côté nécessaire à l’émergence d’une société supportable, à l’humanité de prospérer, selon de nouvelles règles prises collectivement, qui tiendraient réellement compte des limites planétaires et de toutes les pressions environnementales. Sans passer par la case violences, régime autoritaire, société de surveillance, voire pouvoir techno-postfasciste. Sans devoir renoncer à la démocratie.
Ce « modèle » de développement existe depuis 1992, date du rapport de la commission Brundtland (du nom de la Première ministre de Norvège qui présida cette commission internationale) auprès de l’ONU qui avançait le concept de sustainable development (traduit par les experts francophones par « développement durable »)...Cette préoccupation du long terme et des générations à venir est ancienne puisqu’on l’entrevoit déjà vers 1820 chez un Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), naturaliste français, membre de l’Institut de France, progressiste, ami des philosophes des Lumières et précurseur oublié de la science du vivant (6). Ou, plus près de nous, d’un Marx qui, contrairement à la pensée commune, n’a pas ignoré la nature, et n’était pas davantage enfermé dans une isba productiviste comme ont pu le dire et l’écrire des penseurs écologistes et nombre d’écologistes politiques, sans doute pour dissimuler le fait qu’ils avaient eux-mêmes trop souvent tendance à promouvoir une écologie en dehors de tout rapport social. Marx distinguait richesse et valeur et valorisait la valeur d’usage. Il anticipait en réfutant nombre de constructions idéologiques actuelles, essentiellement chez les théoriciens néo-classiques, portant sur les prétendues « valeur économique intrinsèque » de la nature et « valeur économique des services rendus par la nature » que l’on trouve dans les expertises rendues par les organisations multilatérales au sujet de la transition (7).
Est-ce si irréaliste de penser qu’il n’est que temps de tenir compte de la nécessité de soutenabilité et du besoin de démocratie renouvelée, de justice et de bien-être ? Ou est-on si sûrs que le risque d’implosion sociale n’existe pas ?

Au fond, on attend de la transition écologique qu’elle donne à voir non seulement une espérance, un avenir commun dans un monde soumis aux dérèglements tous azimuts (climatique, politiques, sociaux-économiques, géopolitiques), mais aussi de nouveaux imaginaires qui répareraient notre imaginaire national. Qu’elle réponde à cette question simple que se posent les Français : où allons-nous ?
Une transition qui pourrait au passage permettre de refaire Nation.
Serait-ce vraiment si effrayant d’envisager une telle (r)évolution idéologique ?
Le nouveau Premier ministre aura-il suffisamment de Poe en lui pour tirer la leçon sur l’évidence cachée à la vue de tous ? Il n'est pas douteux que si Sébastien Lecornu devait choisir ou être contraint de choisir d'enfiler les chausses d'un Jules Dufaure qui dirigea le gouvernement de centre-droit pendant les débuts de la Troisième République, s’il devait se soumettre à toutes sortes d’accommodements qui ne seraient que déraisonnables, son action serait vouée à l'impuissance et la feuille de route de la France pour la transition écologique pas retrouvée de sitôt...
Dominique Lévèque est cofondateur du PRé et son actuel secrétaire général
(1)Edwin Le Héron (Reims, le 1er juillet 1956 - Bordeaux, le 23 avril 2025), un ami du PRé, économiste, chercheur, professeur des universités à Sciences Po Bordeaux, spécialiste de la monnaie et des questions de modélisations macro-écologiques, sur Radio France : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/regles-budgetaires-ca-chauffe-pour-le-climat-9136518;
Et https://www.pourunerepubliqueecologique.org/2025/05/16/edwin-le-heron-le-distillateur/
(2) Le rapport « Banking on Climate Chaos » publié en juin 2025 est le fait d’ONG : Reclaim Finance, Rainforest Action Network, BankTrack, Center for Energy, Ecology, and Development, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Sierra Club et Urgewald.
(4) https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/09/19/sur-chacun-des-chantiers-qui-ont-occupe-ma-vie-nous-regressons-les-extraits-du-discours-de-jean-pisani-ferry-pour-sa-legion-d-honneur_6641907_3232.html
(5) Léo Hamon évoque le concept de "démocratie continue" dans un article publié en 1984 intitulé "Du référendum à la démocratie continue" (in Revue Française de Science Politique (34e année, n°4-5, 1984)
(6) Jean-Baptiste de Lamarck est cité par René Passet dans sa préface au livre de Sylvie Paucheux et Jean-François Noël, « Economie des ressources naturelles et de l'environnement » (Armand Colin, 1995)
(7) Cf. L'étude « L’économie des écosystèmes et de la biodiversité » (TEEB) dirigée par Pavan Sukhdev (2008-10). Cette étude vise à évaluer les coûts économiques de la perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes, ainsi que les bénéfices de leur conservation et de leur utilisation durable. Les premiers résultats de l’étude ont été présentés lors de la conférence des Nations unies sur la biodiversité à Bonn (2008).
Le rapport de la Cour des comptes est ici :
Écrire commentaire